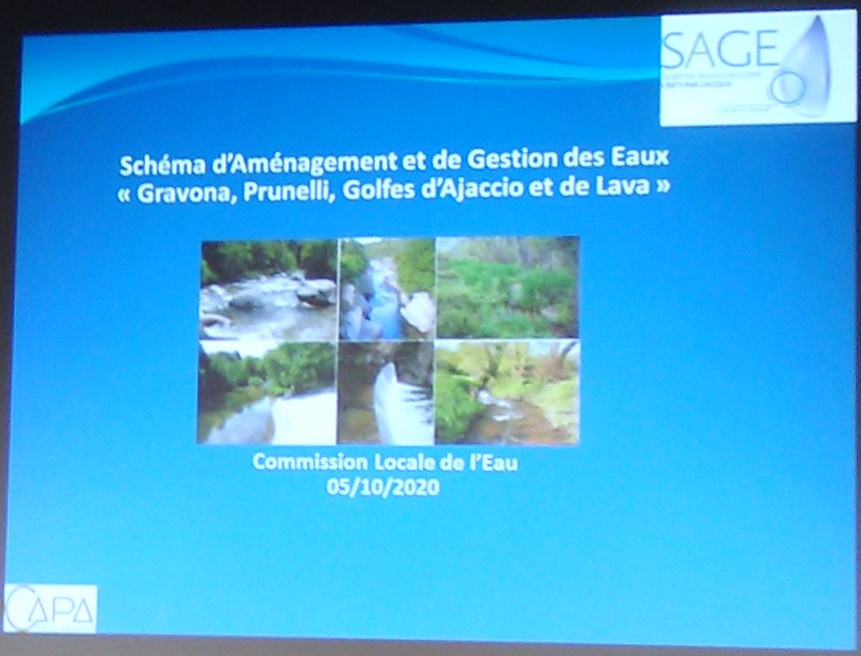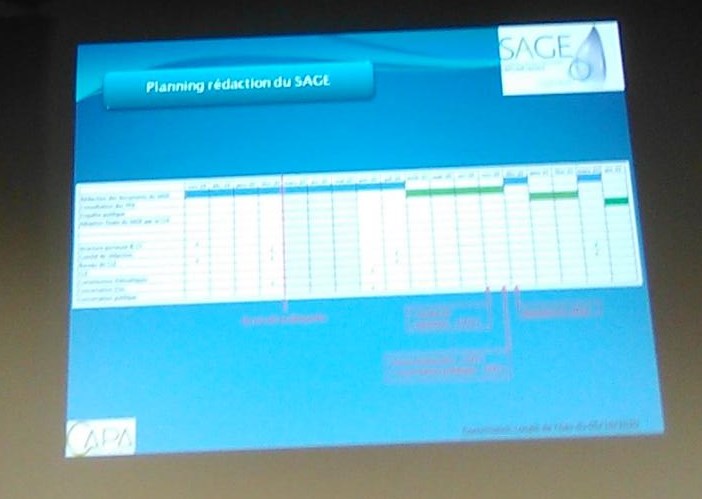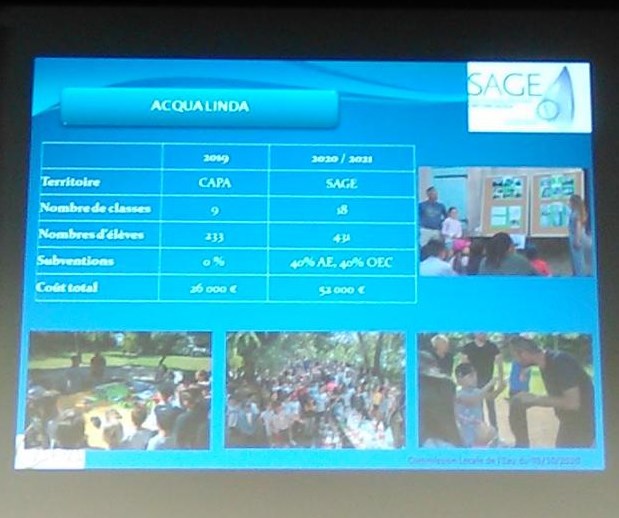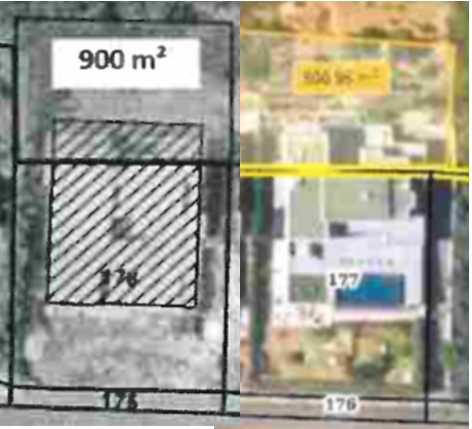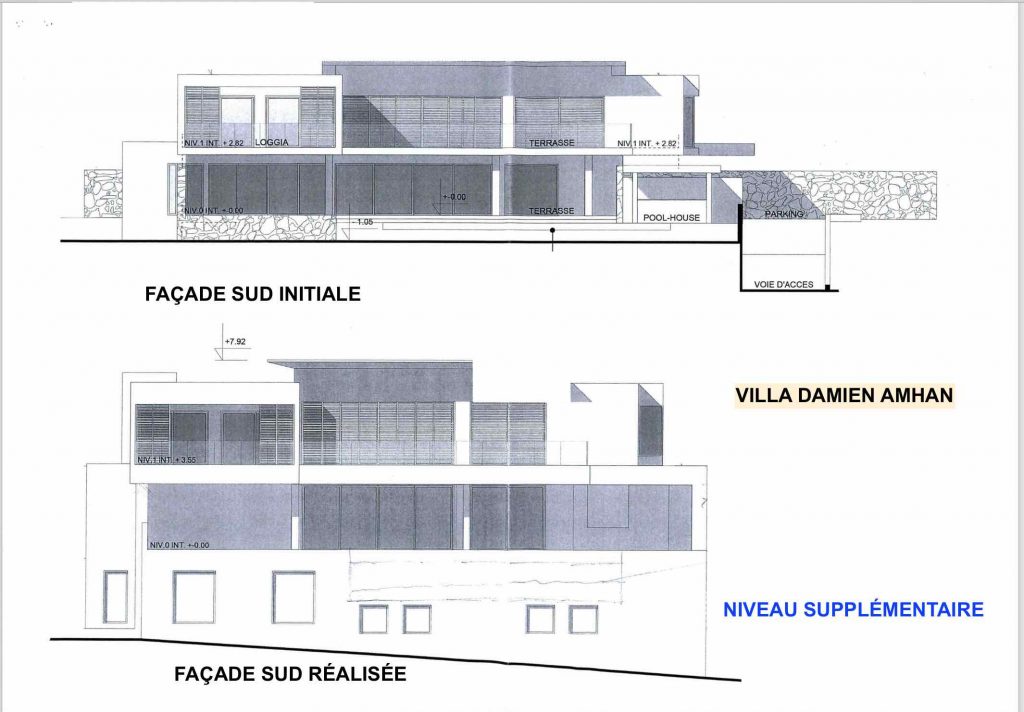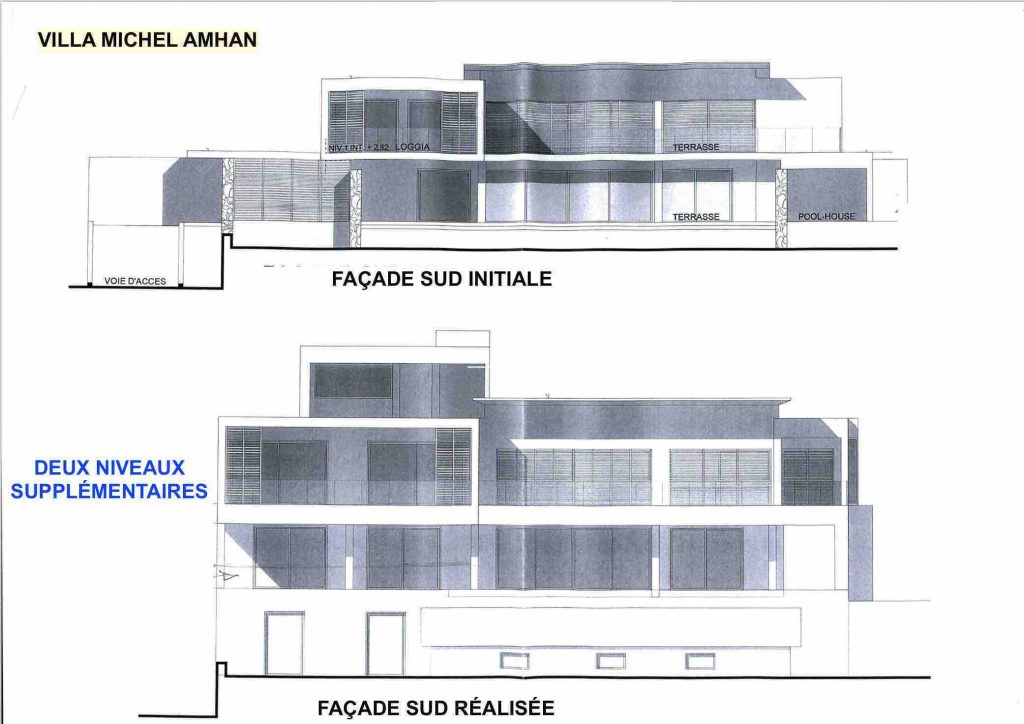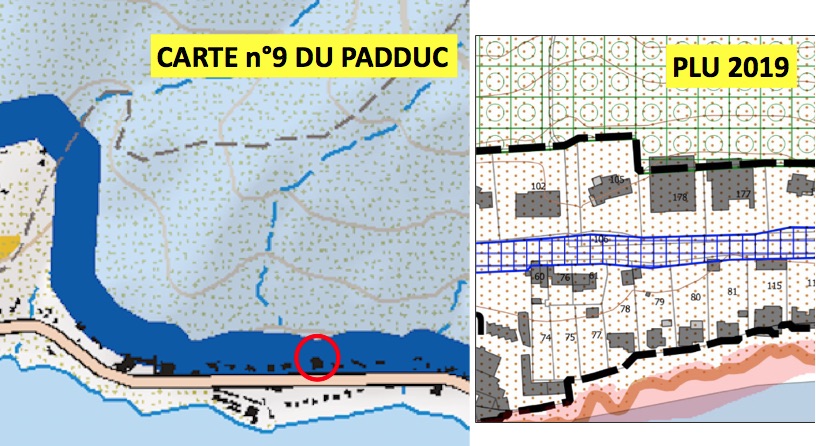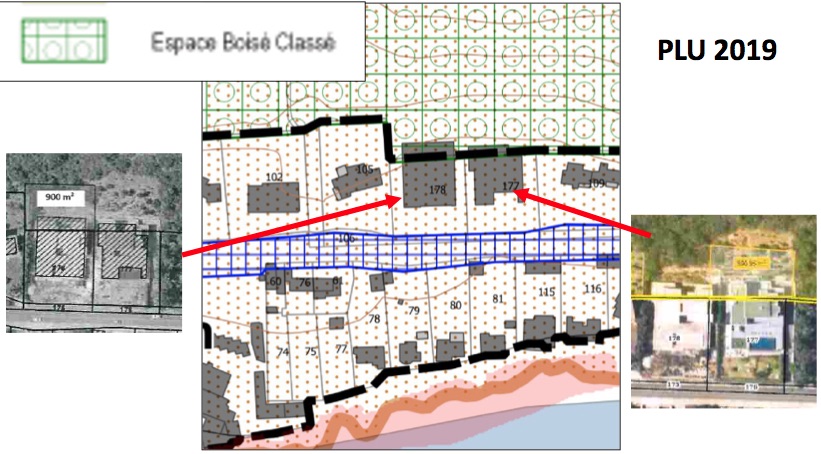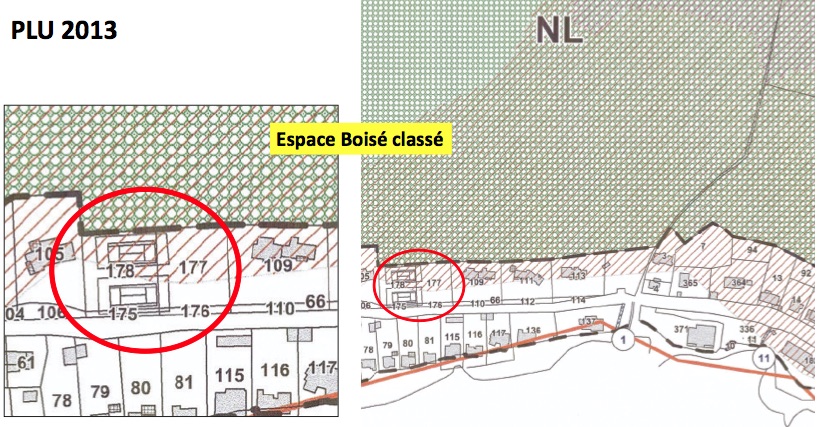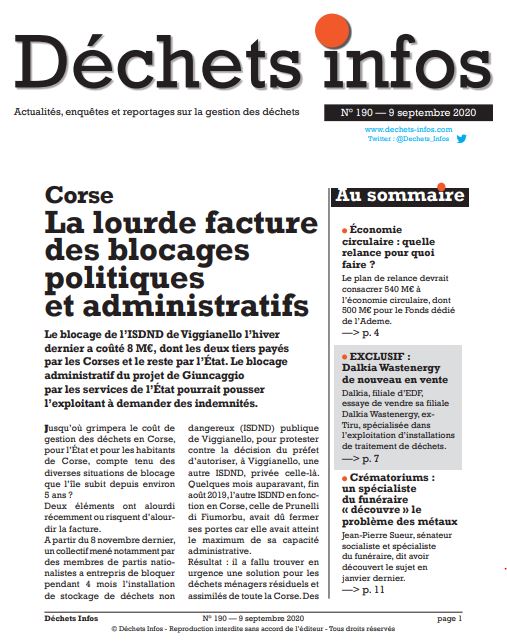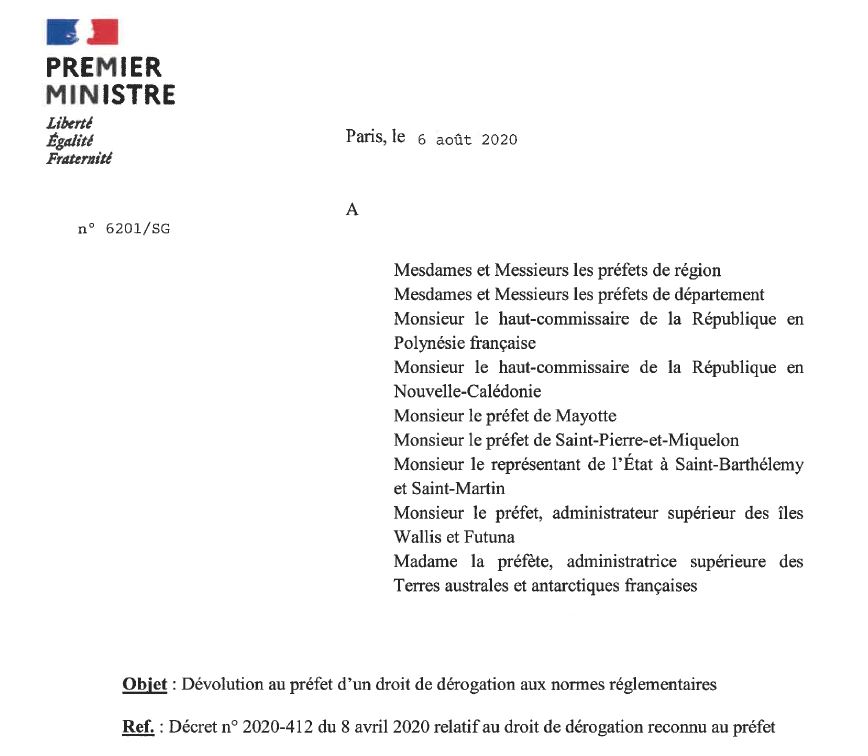Les océans sont devenus la poubelle à plastique de l’humanité
Par l’aggravation du phénomène c’est aujourd’hui une véritable menace pour la biodiversité marine
La Méditerranée est une mer semi fermée. Le renouvellement complet de ses eaux prend environ un siècle. Les échanges entre l’océan atlantique et la Méditerranée se font par le détroit de Gibraltar. La Méditerranée est aujourd’hui menacée par la prolifération de déchets plastiques. Elle est considérée comme l’une des mers les plus polluées au monde.
Les 150 millions d’habitants du bassin méditerranéen font partie des plus gros producteurs de déchets urbains solides au monde : entre 208 et 760 kg par an et par personne. Par ailleurs, le bassin méditerranéen constitue la première destination touristique mondiale avec plus de 200 millions de personnes chaque année. Au sommet de la saison touristique, la génération de déchets peut augmenter de 75 % sur certaines zones littorales.
Chaque jour, on déverse 730 tonnes de déchets en mer Méditerranée, et l’équivalent de 66 000 bennes à ordure de plastiques tous les ans. Selon le dernier rapport du WWF sur la pollution plastique de la Méditerranée (juin 2019) : chaque année 11 200 tonnes de plastique déversées dans la nature se retrouvent en mer Méditerranée dont 21 % viennent s’échouer sur les côtes françaises. Selon la Commission Européenne, 7 déchets sur 10 finissent par couler. L’accumulation de ces déchets forme un tapis qui provoque l’asphyxie des fonds marins, entraînant une disparition progressive de la vie aquatique. C’est une véritable menace sanitaire et économique
En Méditerranée, les micro-plastiques atteignent des niveaux record de concentration : 1,25 million fragments par km2. Soit près de quatre fois le niveau du vortex le plus important de déchets plastiques situé dans le Pacifique nord. Dans les fonds marins méditerranéens on trouve jusqu’à 10 000 fragments de plastique par km2. On estime à 280 milliards les micro-plastiques flottants. Un consommateur moyen de coquillages méditerranéens ingère en moyenne 11 000 morceaux de plastique par an.
La mer Méditerranée est ainsi confrontée à une véritable invasion de déchets et de polluants provenant des bassins-versants de l’ensemble des pays riverains. Le « ramassage » de ces micro-plastiques semble vain face à l’étendue du problème. Le nettoyage des plages constitue un outil intéressant du point de vue de la pédagogie et de l’information, notamment à destination des plus jeunes. Mais il est primordial de garder à l’esprit que le nettoyage est une conséquence et non une solution. Pour lutter contre la plastification des mers, il faut agir en amont et capter ces déchets plastiques avant leur dispersion, voire même contrarier leur production par nos actes d’achats.
LES SOLUTIONS DOIVENT VENIR DE LA TERRE :
- Convaincre les autres pays de la Rive Sud
- limiter drastiquement les plastiques à usage unique : plus de 80 % des déchets déversés dans la mer sont constitués d’objets manufacturés. emballages de produits divers, sacs ou bouteilles plastiques.
- mieux gérer les déchets à terre, pour empêcher qu’ils atteignent la mer
- Mieux gérer les grands fleuves qui se jettent en Méditerranée, (Rhône – l’Èbre, La Segura : Espagne le Pô, l’Adige Italie – le Nil Egypte – La Malouya Maroc – le Chelif Algérie…,
- Ainsi que les fleuves côtiers, comme le Var, l’Aude, l’Orb… Ils ont aussi une incidence
- Soutenir la recherche: inventer de nouveaux matériaux vraiment biodégradables et de nouveaux produits phytosanitaires non toxiques.
- Introduire une fiscalité pollueur-payeur pour les industriels: pour aligner le prix du plastique neuf sur celui du plastique recyclé dont le coût est actuellement 30 % plus élevé.
- Imposer des directives plus drastiques dans les aires marines protégées et les sanctuaires marins. (pollution hydrocarbures, fumées, le bruit). Sanctuaire des Pélagos : c’est un espace maritime de 87 500 km² faisant l’objet d’un Accord entre l’Italie, Monaco et la France pour la protection des mammifères marins qui le fréquentent.
- Inciter les pêcheurs à remonter les filets dérivants détectés en mer. Organiser la collecte gratuite de ces matériels de pêche usagés ou défectueux dans les ports, avec l’installation d’espaces dédiés pour le recyclage du matériel de pêche.
- LE RÔLE DES CITOYENSNe rien jeter dans la mer ou par terre, on est responsable des déchets qu’on génère. Il faut s’approprier les règles de gestion des déchets pour leur reconditionnement ultérieur ou leur réutilisation. (Le réemploi des objets est source d’emplois pérennes non délocalisables)
Éviter les barquettes en plastique qui passent au micro ondes. …Bannir les pailles. … Les sacs plastiques… Les cotons tiges.. Éviter les produits avec suremballage plastique… Pas de bouteilles ou produit en plastique coloré, (qui ne se recyclent pas).. Consommer des produits bruts et acheter local.. Acheter en vrac… Choisir sa lessive avec discernement ou la faire soi même.. Privilégier les shampoings et les savons solides.
Nos actes d’achats doivent aussi faire pression sur les industriels pour faire évoluer leurs pratiques.